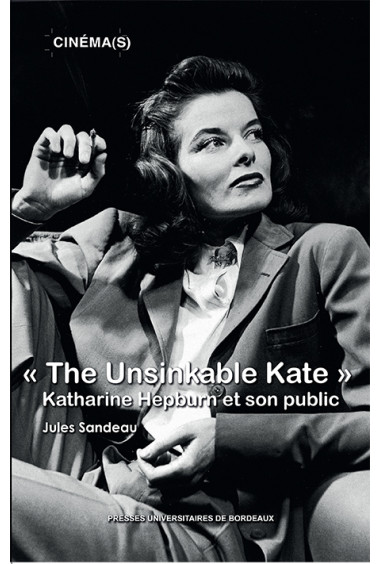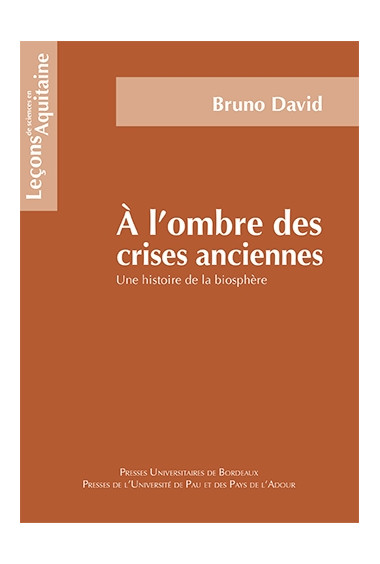L'insulte
ISBN : 978-2-86781-964-3
Nombre de pages : 428
Format : 15 x 21
Date de sortie : 2015/03
L’insulte se tient dans une position charnière entre la parole et le cri, la résistance défensive et la pulsion destructrice, l’allégeance au code et l’insoumission. Traversée de paradoxes, l’insulte nous échappe par où, justement, elle fonctionne : porteuse d’une violence dévastatrice, elle n’en représente pas moins, dans l’ordre de la parole, une alternative à cette même violence.
L’insulte se tient dans une position charnière entre la parole et le cri, la résistance défensive et la pulsion destructrice, l’allégeance au code et l’insoumission. Traversée de paradoxes, l’insulte nous échappe par où, justement, elle fonctionne : porteuse d’une violence dévastatrice, elle n’en représente pas moins, dans l’ordre de la parole, une alternative à cette même violence. Tuer symboliquement l’autre c’est – par une sorte de conversion du somatique en sémiotique – halluciner la mort de celui-là même à qui l’on doit finalement laisser la vie sauve, ce qui n’est pas un moindre paradoxe pour une pratique aussi radicalement meurtrière que l’insulte, quand on sait combien celui qu’on entend traiter par le mépris fait linguistiquement l’objet de toutes nos attentions. Si l’effet de l’injure dépend autant de celui qui en est la cible que de celui qui la profère (n’offense pas qui veut), l’insulte n’est pas qu’affaire d’encodage et de décodage : c’est aussi la stupeur de celui qui s’entend proférer des injures et la terreur de la découverte de sa propre rage, c’est l’intolérable reviviscence de la scène maintes fois jouée, rejouée et conflictualisée, c’est la soudaine prise de conscience d’une certaine faillite de la pensée, doublée du constat d’impuissance que ne parvient pas à dissimuler la toute-puissance dont se drape celui qui y a recours : comme pour tout meurtre, celui qui tue par les mots se suicide un peu en perpétrant son crime.