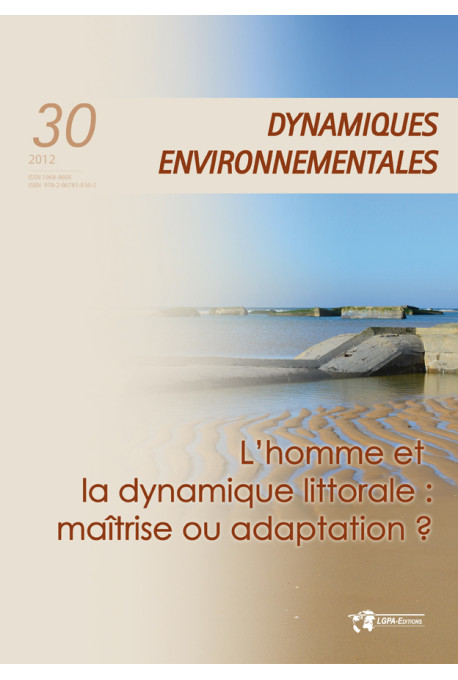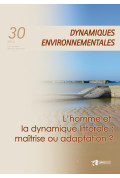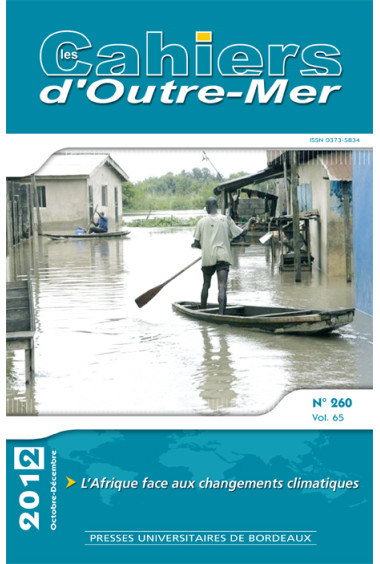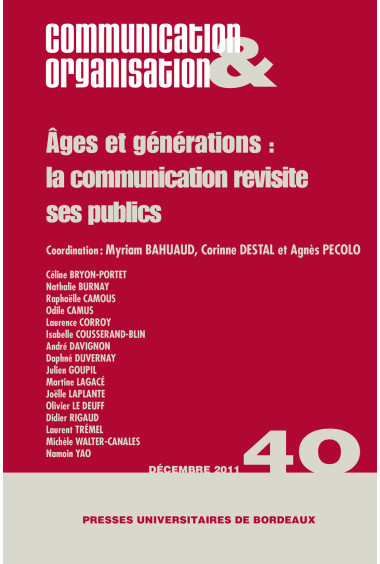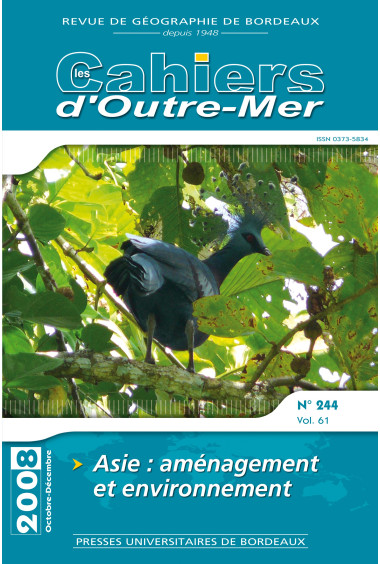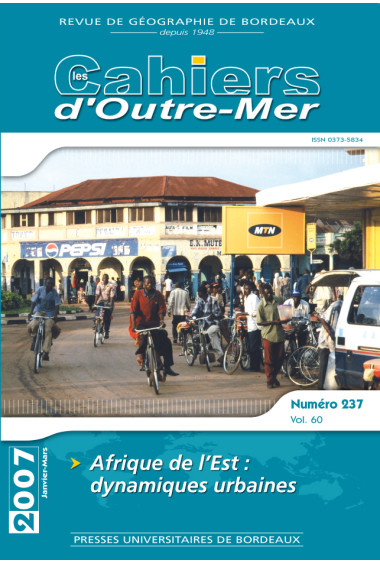Les plages de la Côte d’Opale : maîtriser la nature ou agir avec elle ? - Article 6
ISBN : 978-2-86781-816-5
Nombre de pages : 17
Format : 21 x 29,7
Date de sortie : 2014/02
La côte d’Opale s’étend de l’estuaire de la Somme à la frontière belge, en bordure d’une mer peu profonde où l’onde de marée et la dérive littorale se propagent du sud vers le nord.
La côte d’Opale s’étend de l’estuaire de la Somme à la frontière belge, en bordure d’une mer peu profonde où l’onde de marée et la dérive littorale se propagent du sud vers le nord. Les deux tiers du littoral correspondent à une côte sableuse basse, généralement bordée de dunes. Les fonds marins proches des côtes françaises sont riches en bancs sableux ou sablo-graveleux qui constituent une énorme réserve sédimentaire pour les systèmes côtiers. Longtemps sous-estimée, la dynamique éolienne contrôlée par des vents dominants de secteur ouest participe de façon décisive au fonctionnement des systèmes plage-dune. Le littoral caractéristique de la côte d’Opale est une large plage de plusieurs centaines de mètres à marée basse, façonnée en barres et bâches et adossée à une avant-dune dont le modelé est extrêmement changeant d’un cycle de marée à l’autre, d’une année à l’autre. Le suivi morphologique de ces systèmes plage-dune a montré leur remarquable résilience, chaque fois que l’homme n’a pas perturbé leur fonctionnement naturel. Il s’ensuit, dans de nombreux secteurs, une stabilité du trait de côte depuis plus de 60 ans qui dément l’idée répandue d’une érosion rapide et généralisée. Dès la fin du 19ème siècle, apparaissent les premières stations balnéaires qui investissent les dunes et parfois le haut de plage, dans une méconnaissance complète du fonctionnement morphosédimentaire de ces littoraux. Fortement secoué par les deux guerres mondiales, le développement du tourisme connaît un nouvel élan à partir de la fin des années 1950. Jusqu’à la fin des années 1980, c’est le temps des promoteurs et des aménageurs qui veulent soumettre la nature à leurs ambitions. La prise de conscience de la valeur environnementale de milieux dont la fragilité est désormais reconnue va peu à peu transformer la vision des décideurs politiques. Le temps de la gestion intégrée et durable est venue. Les exemples du Touquet, de Merlimont et de Wissant servent à illustrer ces nouvelles stratégies de gestion.