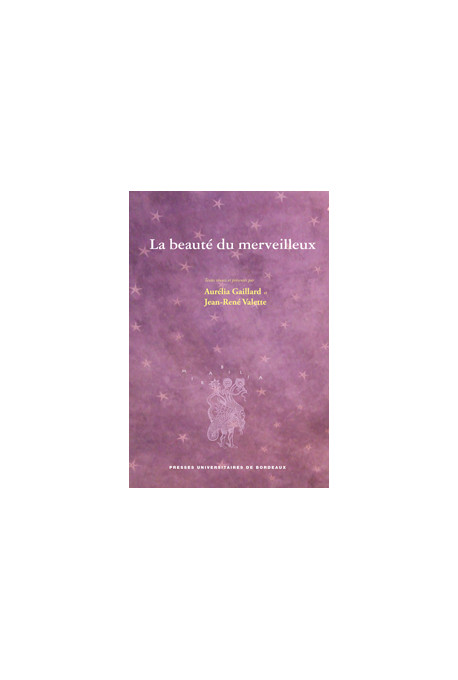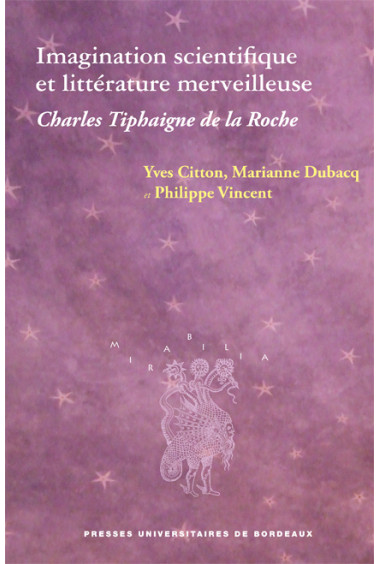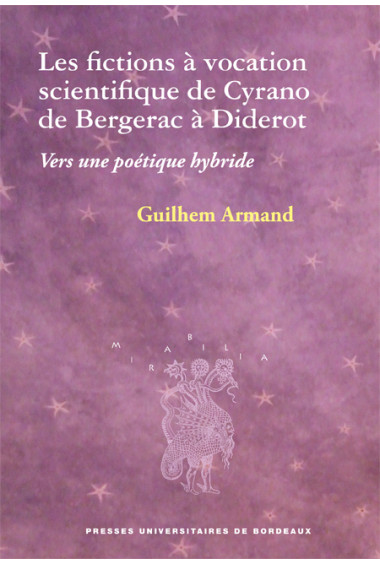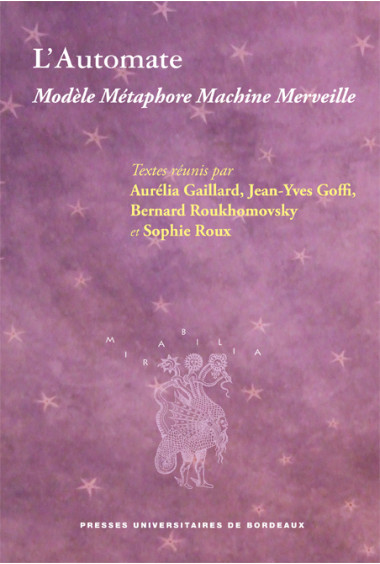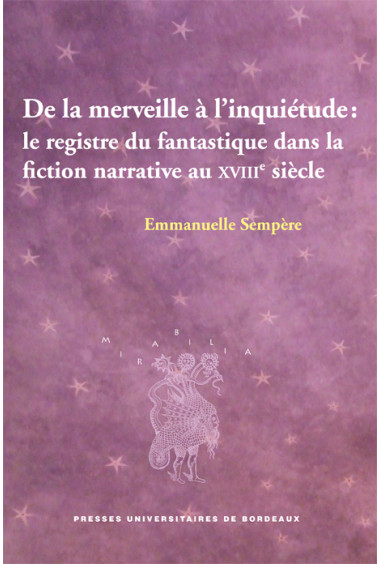Anciennes collections - Mirabilia
La beauté du merveilleux
ISBN : 978-2-86781-651-2
Nombre de pages : 370
Format : 16 x 24
Date de sortie : 2011
L’ouvrage rassemble dix-huit études de spécialistes de l’Antiquité au XXe siècle autour d’une question transversale encore jamais clairement posée : peut-on parler d’un beau merveilleux ?
Avant-propos
Bernard Vouilloux – Le merveilleux entre savoir, croyance et fiction
I. Antiquité
Christine Hunzinger – Entre séduction et déception : l'ambiguïté de la beauté du merveilleux dans l'épopée grecque archaïque
Valérie Naas – Y a-t-il une beauté du merveilleux dans la Rome antique ? L'exemple des mirabilia dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien
Anne-Isabelle Bouton-Touboulic – Monstres et merveilles dans les Confessions de saint Augustin
II. Moyen Âge
Christine Ferlampin-Acher – La beauté du monstre dans les romans médiévaux : de la peau de dragon à l'Incarnation du Christ
Dominique Poirel – Mira pulcritudo : de l'étonnement à l'émerveillement selon Hugues de Saint-Victor
Éléonore Andrieu – Le regard stupéfait, la beauté et la mise en ordres dans les textes de Suger
Florence Plet – Le Bel Inconnu de Renaud de Beaujeu ou l'onomastique d'un roman breton : n'importe quel Beau est-il merveilleux ?
Marie-Pascale Halary – "Ceste senefiance est bele et merveilleuse" : la beauté du merveilleux ou le plaisir de la senefiance dans le Perlesvaus et la Queste del Saint Graal
Jean-René Valette – La belle porteuse du Graal ou la beauté des signes
III. De la Renaissance aux Lumières
Isabelle Pantin – Esthétique du merveilleux et "portraits" de la nature dans la poésie de la Renaissance
Baldine Saint Girons – Le beau, le sublime et le merveilleux. La révolution burkienne
Nathalie Kremer – La belle alliance du merveilleux et du vraisemblable dans la théorie classique
Aurélia Gaillard – Merveille et esthétique de la surprise : l'effet merveilleux des Lumières
IV. Du Romantisme au Surréalisme
Florence Fournet – Le merveilleux chrétien. Chateaubriand ou la mise à l'épreuve paradoxale de la modernité esthétique
Vérane Partensky – L'autre langue : les écritures merveilleuses dans la tradition romantique allemande
Fabienne Brugère – Peut-on faire l'économie de la beauté du merveilleux ? Lecture de Benjamin
Claude Leroy – Pieyre de Mandiargues ou le montreur de merveilles
Postface
Aurélia Gaillard, Jean-René Valette – Pour une esthétique
L’ouvrage rassemble dix-huit études de spécialistes de l’Antiquité au XXe siècle autour d’une question transversale encore jamais clairement posée : peut-on parler d’un beau merveilleux ? Ou encore : le merveilleux est-il le beau ? Et que faire alors de la laideur, du monstrueux, de l’inquiétant, du sublime ? L’ensemble vise à établir un lien entre la question esthétique du beau et l’essentielle fascination que, sous la diversité de ses formes, le merveilleux peut susciter. Il peut se lire aussi comme un manifeste « pour une esthétique du merveilleux », qui entend revendiquer, à côté des approches historiques, ethnologiques, imaginaires du merveilleux, une approche esthétique. Dans cette optique, qui n’exclut pas les autres, ce qui fonde le merveilleux est aussi bien la chose merveilleuse (fait ou objet), que le regard qui l’émerveille ou la « merveille ». Le merveilleux n’est pas tant une question de principe voire d’origine, de destinateur ou de créateur (éventuellement Créateur), que de destinataire et même de spectateur. Plus exactement, elle n’est ni tout à fait dans l’objet ni tout à fait dans le sujet mais dans la relation entre les deux : acte, geste esthétique, donc. La merveille est performative : elle n’existe que lorsqu’on l’expérimente, c’est le regard qui la fonde. Ce questionnement n’entend cependant pas être anhistorique, comme en témoigne la structuration diachronique de l’ouvrage : car les termes de la relation esthétique ne sauraient être les mêmes selon que les critères de définition de la chose merveilleuse, d’une part, et de la catégorie esthétique, de l’autre, se modifient d’une époque à l’autre.